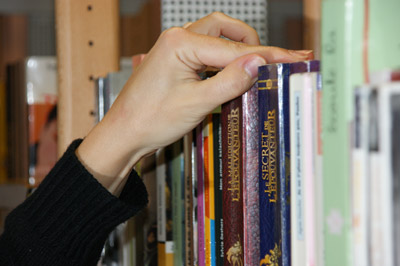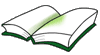Association genevoise du musée des tramways
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les étagères virtuelles... |
Détail de l'auteur
Auteur Elie Mandrillon |
Documents disponibles écrits par cet auteur


 Affiner la recherche Interroger des sources externes
Affiner la recherche Interroger des sources externesLes autorails diesel-électriques Brissonneau et Lotz / Elie Mandrillon in Transports et patrimoine ferroviaires, N° 414 (Novembre/Décembre 2022)
Titre : Les autorails diesel-électriques Brissonneau et Lotz Type de document : texte imprimé Auteurs : Elie Mandrillon, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : P. 4-26 Langues : Français Catégories : [Mots-clefs] Allemagne de l'Est
[Mots-clefs] Aménagement intérieur
[Mots-clefs] Anjou
[Mots-clefs] Autorail
[Mots-clefs] Brissonneau & Lotz
[Mots-clefs] Caractéristique technique
[Mots-clefs] Charente (département)
[Mots-clefs] Chemin de fer privé
[Mots-clefs] Côtes-du-Nord
[Mots-clefs] Doubs (département)
[Mots-clefs] Exploitation
[Mots-clefs] Finistère
[Mots-clefs] France
[Mots-clefs] Gazogène
[Mots-clefs] Guerre 1939-45
[Mots-clefs] Histoire
[Mots-clefs] Livrée
[Mots-clefs] Modernisation
[Mots-clefs] Morbihan
[Mots-clefs] Panne
[Mots-clefs] Traction Diesel
[Mots-clefs] Traction électrique
[Mots-clefs] Vosges
[Compagnie] CdN
[Compagnie] CFD (Doubs)
[Compagnie] CFDF
[Compagnie] CFS (France)
[Compagnie] CFSNE
[Compagnie] CM (Morbihan)
[Compagnie] DR (RDA)
[Compagnie] EC
[Compagnie] SE (France)
[Année] 1893-1976Index. décimale : 4390 Chemin de fer interurbain et vicinal - histoire - généralités Résumé : A la fin du 19e siècle, la vapeur règne en maître dans les chemins de fer mais ses contraintes et son faible rendement poussent les compagnies à rechercher d'autres systèmes. La traction électrique nécessite de lourdes infrastructures et des essais sont menés en 1894 avec une locomotive vapeur-électrique. Le système se révèle lourd et complexe. Le moteur à explosion reste le seul qui permet de se passer des contraintes de stockage de l'énergie ou de sa distribution tout au long de la ligne. Son rendement médiocre est compensé par la capacité énergétique et le faible prix du carburant. Au début du 20e siècle apparaissent les premiers véhicules thermo-électriques. L'utilisation de l'électricité permet de se passer des fragiles organes de transmission mécanique, mais le rendement est environ 25% plus faible qu'avec une telle transmission. Les premiers autorails diesel-électrique de Brissonneau et Lotz sont fournis au réseau SE de l'Anjou en 1934. Dans la seconde moitié des années 1940, le réseau ferme et les autorails sont revendus aux Chemins de fer du Doubs. A la fermeture des dernières lignes du réseau en 1952, ils sont démolis. La Compagnie des chemins de fer d'intérêt local du Morbihan acquiert également des autorails Brissonneau et Lotz en 1935. A la fermeture du réseau en 1947, les autorails subsistants sont vendus au réseau voisin des Côtes-du-Nord. Mais les moteurs fatigués par le manque d'entretien durant la guerre et l'inexpérience du personnel avec la traction électrique conduisent rapidement à leur transformations en remorques. A la fermeture du réseau en 1956, celles-ci sont vendues à l'armée pour utilisation en Afrique du Nord. La Compagnie des chemins de fer économiques des Charentes acquiert 7 autorails en 1936. La fermeture du réseau est décidée deux ans plus tard, mais retardée par la guerre. La pénurie de carburant conduit à l'arrêt des autorails en septembre 1940. Leur transformation avec un gazogène se heurte à de nombreuses difficultés. Trois autorails sont vendus à l'Allemagne en 1942-43, un au réseau du Finistère, deux sont démolis suite aux bombardements de la gare d'Angoulême en 1944 et le dernier reprend du service en 1945 jusqu'à la fermeture du réseau fin 1946. Le dernier des trois autorails partis en Allemagne circulera en Poméranie jusqu'à la fermeture de la ligne en 1971. L'autorail parti sur le réseau du Finistère est utilisé pour les transports de l'organisation Todt. Après la libération, il est remis en état fin 1945 et circule jusqu'à la fermeture du réseau en 1946. Il est vendu aux CdN en 1947, mais son état conduit rapidement à sa transformation en remorque. Celle-ci est également vendue à l'armée à la fermeture du réseau. Le dernier autorail resté sur le réseau des Charentes est acquis par la Compagnie des chemins de fer secondaires du Nord-Est et reprend du service en 1949, jusqu'à la fermeture de la ligne en 1950. Il sera feraillé quelques années plus tard, les tentatives de revente n'ayant pas abouti. Dans les Vosges, la CFS met en service en 1937 un autorail Brissonneau & Lotz sur la ligne de la vallée de Celles. Il y circule jusqu'à la fermeture en 1950. Malgré ses bonnes performance, ce matériel arrivé tardivement sur le marché des autorails à voie métrique ne parvient pas à s'imposer. Le prix d'achat plus élevé que celui du matériel à transmission mécanique ainsi que la nécessité de disposer d'un personnel électricien spécialisé se sont révélés des freins à une époque où les restrictions financières et les compression du personnel étaient la règle.
in Transports et patrimoine ferroviaires > N° 414 (Novembre/Décembre 2022) . - P. 4-26[article] Les autorails diesel-électriques Brissonneau et Lotz [texte imprimé] / Elie Mandrillon, Auteur . - 2022 . - P. 4-26.
Langues : Français
in Transports et patrimoine ferroviaires > N° 414 (Novembre/Décembre 2022) . - P. 4-26
Catégories : [Mots-clefs] Allemagne de l'Est
[Mots-clefs] Aménagement intérieur
[Mots-clefs] Anjou
[Mots-clefs] Autorail
[Mots-clefs] Brissonneau & Lotz
[Mots-clefs] Caractéristique technique
[Mots-clefs] Charente (département)
[Mots-clefs] Chemin de fer privé
[Mots-clefs] Côtes-du-Nord
[Mots-clefs] Doubs (département)
[Mots-clefs] Exploitation
[Mots-clefs] Finistère
[Mots-clefs] France
[Mots-clefs] Gazogène
[Mots-clefs] Guerre 1939-45
[Mots-clefs] Histoire
[Mots-clefs] Livrée
[Mots-clefs] Modernisation
[Mots-clefs] Morbihan
[Mots-clefs] Panne
[Mots-clefs] Traction Diesel
[Mots-clefs] Traction électrique
[Mots-clefs] Vosges
[Compagnie] CdN
[Compagnie] CFD (Doubs)
[Compagnie] CFDF
[Compagnie] CFS (France)
[Compagnie] CFSNE
[Compagnie] CM (Morbihan)
[Compagnie] DR (RDA)
[Compagnie] EC
[Compagnie] SE (France)
[Année] 1893-1976Index. décimale : 4390 Chemin de fer interurbain et vicinal - histoire - généralités Résumé : A la fin du 19e siècle, la vapeur règne en maître dans les chemins de fer mais ses contraintes et son faible rendement poussent les compagnies à rechercher d'autres systèmes. La traction électrique nécessite de lourdes infrastructures et des essais sont menés en 1894 avec une locomotive vapeur-électrique. Le système se révèle lourd et complexe. Le moteur à explosion reste le seul qui permet de se passer des contraintes de stockage de l'énergie ou de sa distribution tout au long de la ligne. Son rendement médiocre est compensé par la capacité énergétique et le faible prix du carburant. Au début du 20e siècle apparaissent les premiers véhicules thermo-électriques. L'utilisation de l'électricité permet de se passer des fragiles organes de transmission mécanique, mais le rendement est environ 25% plus faible qu'avec une telle transmission. Les premiers autorails diesel-électrique de Brissonneau et Lotz sont fournis au réseau SE de l'Anjou en 1934. Dans la seconde moitié des années 1940, le réseau ferme et les autorails sont revendus aux Chemins de fer du Doubs. A la fermeture des dernières lignes du réseau en 1952, ils sont démolis. La Compagnie des chemins de fer d'intérêt local du Morbihan acquiert également des autorails Brissonneau et Lotz en 1935. A la fermeture du réseau en 1947, les autorails subsistants sont vendus au réseau voisin des Côtes-du-Nord. Mais les moteurs fatigués par le manque d'entretien durant la guerre et l'inexpérience du personnel avec la traction électrique conduisent rapidement à leur transformations en remorques. A la fermeture du réseau en 1956, celles-ci sont vendues à l'armée pour utilisation en Afrique du Nord. La Compagnie des chemins de fer économiques des Charentes acquiert 7 autorails en 1936. La fermeture du réseau est décidée deux ans plus tard, mais retardée par la guerre. La pénurie de carburant conduit à l'arrêt des autorails en septembre 1940. Leur transformation avec un gazogène se heurte à de nombreuses difficultés. Trois autorails sont vendus à l'Allemagne en 1942-43, un au réseau du Finistère, deux sont démolis suite aux bombardements de la gare d'Angoulême en 1944 et le dernier reprend du service en 1945 jusqu'à la fermeture du réseau fin 1946. Le dernier des trois autorails partis en Allemagne circulera en Poméranie jusqu'à la fermeture de la ligne en 1971. L'autorail parti sur le réseau du Finistère est utilisé pour les transports de l'organisation Todt. Après la libération, il est remis en état fin 1945 et circule jusqu'à la fermeture du réseau en 1946. Il est vendu aux CdN en 1947, mais son état conduit rapidement à sa transformation en remorque. Celle-ci est également vendue à l'armée à la fermeture du réseau. Le dernier autorail resté sur le réseau des Charentes est acquis par la Compagnie des chemins de fer secondaires du Nord-Est et reprend du service en 1949, jusqu'à la fermeture de la ligne en 1950. Il sera feraillé quelques années plus tard, les tentatives de revente n'ayant pas abouti. Dans les Vosges, la CFS met en service en 1937 un autorail Brissonneau & Lotz sur la ligne de la vallée de Celles. Il y circule jusqu'à la fermeture en 1950. Malgré ses bonnes performance, ce matériel arrivé tardivement sur le marché des autorails à voie métrique ne parvient pas à s'imposer. Le prix d'achat plus élevé que celui du matériel à transmission mécanique ainsi que la nécessité de disposer d'un personnel électricien spécialisé se sont révélés des freins à une époque où les restrictions financières et les compression du personnel étaient la règle. Les autorails JL (Jean Laborie) / Elie Mandrillon in Transports et patrimoine ferroviaires, N° 427 (Janvier/Février 2025)
Titre : Les autorails JL (Jean Laborie) Type de document : texte imprimé Auteurs : Elie Mandrillon, Auteur Année de publication : 2025 Article en page(s) : P. 4-18 Langues : Français Catégories : [Mots-clefs] 1
[Mots-clefs] 2
[Mots-clefs] 3-7
[Mots-clefs] Aménagement intérieur
[Mots-clefs] Ap
[Mots-clefs] Autorail
[Mots-clefs] Caractéristique technique
[Mots-clefs] Chemin de fer privé
[Mots-clefs] Doubs (département)
[Mots-clefs] Essai
[Mots-clefs] Exploitation
[Mots-clefs] France
[Mots-clefs] Freinage
[Mots-clefs] Guerre 1939-45
[Mots-clefs] Histoire
[Mots-clefs] Jura (département)
[Mots-clefs] Patinage
[Mots-clefs] Pneu rail
[Mots-clefs] Roue Elastique
[Mots-clefs] Voie métrique
[Ligne] Andelot
[Ligne] Besançon
[Ligne] Foncine-Le-Haut
[Ligne] Levier
[Ligne] Lons-le-Saunier
[Ligne] Pontarlier
[Ligne] St-Claude
[Compagnie] AL (Jura)
[Compagnie] CFD (Doubs)
[Compagnie] CFV (France)
[Compagnie] CGM
[Compagnie] PM
[Année] 1933-1950Index. décimale : 4340 Chemin de fer interurbain et vicinal - véhicule - généralités, histoire, caractéristiques techniques (pour une série particulière, sinon, voir classe 493*(si lié à une compagnie) ou 61** Résumé : Jean-Marie Teillet-Laborie, ingénieur civil des Ponts-ec-Chaussées, hérite, après la première guerre mondiale, des concessions ferroviaires de son père. Il s'attache à la modernisation de ses réseaux pour optimiser les coûts de transport et le confort des voyageurs. En 1930, le Département du Doubs cherche à faire des économies dans l'exploitation de son réseau et à enrayer la désaffection des voyageurs. La Micheline semble alors être une solution, mais les expériences menées avec ce véhicules montrent que l'usure des pneus rail sur les petits rails des voies métriques sera trop importante. M. Laborie propose alors un autorail léger, construit sur la base d'un châssis de camionnette Renault SX et muni de quatre essieux pour répartir le poids au mieux. Les trois essieux arrières sont munis de semi-pneus et l'essieu avant, moteur, de pneumatiques routiers. Lors des premiers essais en 1933 sur les lignes au départ de Pontarlier, cet autorail, numéroté AP 1, atteint la vitesse de 80 km/h. Le Département du Doubs ne s'empresse pas d'acheter des autorails de série, jugés trop coûteux et dont l'adhérence de l'essieu moteur et la puissance de freinage suscitent des réserve de l'ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées. De nouveaux essais menés en juillet et août 1933 confirment la tendance au patinage par temps de pluie. Un second prototype, numéroté AP 2, est construit en fin d'année, il effectue ses premiers essais sur le CGM. Les AP 1 et 2 réalisent plusieurs voyages de démonstration, M. Laborie tentant de vendre son invention à d'autres réseaux, mais sans succès. Les deux autorails sont finalement mis en service régulier dès le 1er mars 1934 sur le réseau du Doubs. Sur rails secs, ces véhicules permettent d'appréciables gains de temps et l'AP 2 atteint même 100 km/h, record de vitesse sur voie métrique à l'époque. Une série de 5 autorails (AP 3-7) est finalement commandée par le Département du Doubs en 1934. Des problèmes surviennent sur les semi-pneus de ces véhicules et ils doivent être remplacés, ce qui améliore les performances des véhicules. Malgré cela, le Département résilie sa commande. M. Laborie est tout de même autorisé à poursuivre les essais sur le réseau et l'utilisation de roues avec interposition de semi-pneu entre le centre des roues et un bandage métallique donne de bons résultats en traction, mais le freinage ne répond plus aux normes. Un système de frein électromagnétique est testé mais il ne donne pas les résultats attendus et est abandonné. Les 5 autorails sont finalement tout de même mis en service sur le réseau en 1936, sur la base d'un contrat de location-vente (1 fr. par kilomètre, jusqu'à concurrence de 70'000 fr.). Les années suivantes, la fiabilité des autorails s'améliore et ils sont régulièrement utilisés. Avec le déclenchement de la seconde guerre mondiale et le regain de trafic, ces autorails de trop faible capacité sont garés. A la fin de la guerre, les CFD les louent au département du Jura qui les emploie dès 1945 sur la ligne Lons-le-Saunier - St-Claude des CFV en remplacement des autocars. Certains autorails reviennent dans le Doubs en 1946, mais ils sont peu utilisés, en raison de leur faible capacité, puis sont remplacés par de nouveaux autorails. Après la suppression du trafic voyageur en 1950, l'un est transformé en camionnette et les autres démolis.
in Transports et patrimoine ferroviaires > N° 427 (Janvier/Février 2025) . - P. 4-18[article] Les autorails JL (Jean Laborie) [texte imprimé] / Elie Mandrillon, Auteur . - 2025 . - P. 4-18.
Langues : Français
in Transports et patrimoine ferroviaires > N° 427 (Janvier/Février 2025) . - P. 4-18
Catégories : [Mots-clefs] 1
[Mots-clefs] 2
[Mots-clefs] 3-7
[Mots-clefs] Aménagement intérieur
[Mots-clefs] Ap
[Mots-clefs] Autorail
[Mots-clefs] Caractéristique technique
[Mots-clefs] Chemin de fer privé
[Mots-clefs] Doubs (département)
[Mots-clefs] Essai
[Mots-clefs] Exploitation
[Mots-clefs] France
[Mots-clefs] Freinage
[Mots-clefs] Guerre 1939-45
[Mots-clefs] Histoire
[Mots-clefs] Jura (département)
[Mots-clefs] Patinage
[Mots-clefs] Pneu rail
[Mots-clefs] Roue Elastique
[Mots-clefs] Voie métrique
[Ligne] Andelot
[Ligne] Besançon
[Ligne] Foncine-Le-Haut
[Ligne] Levier
[Ligne] Lons-le-Saunier
[Ligne] Pontarlier
[Ligne] St-Claude
[Compagnie] AL (Jura)
[Compagnie] CFD (Doubs)
[Compagnie] CFV (France)
[Compagnie] CGM
[Compagnie] PM
[Année] 1933-1950Index. décimale : 4340 Chemin de fer interurbain et vicinal - véhicule - généralités, histoire, caractéristiques techniques (pour une série particulière, sinon, voir classe 493*(si lié à une compagnie) ou 61** Résumé : Jean-Marie Teillet-Laborie, ingénieur civil des Ponts-ec-Chaussées, hérite, après la première guerre mondiale, des concessions ferroviaires de son père. Il s'attache à la modernisation de ses réseaux pour optimiser les coûts de transport et le confort des voyageurs. En 1930, le Département du Doubs cherche à faire des économies dans l'exploitation de son réseau et à enrayer la désaffection des voyageurs. La Micheline semble alors être une solution, mais les expériences menées avec ce véhicules montrent que l'usure des pneus rail sur les petits rails des voies métriques sera trop importante. M. Laborie propose alors un autorail léger, construit sur la base d'un châssis de camionnette Renault SX et muni de quatre essieux pour répartir le poids au mieux. Les trois essieux arrières sont munis de semi-pneus et l'essieu avant, moteur, de pneumatiques routiers. Lors des premiers essais en 1933 sur les lignes au départ de Pontarlier, cet autorail, numéroté AP 1, atteint la vitesse de 80 km/h. Le Département du Doubs ne s'empresse pas d'acheter des autorails de série, jugés trop coûteux et dont l'adhérence de l'essieu moteur et la puissance de freinage suscitent des réserve de l'ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées. De nouveaux essais menés en juillet et août 1933 confirment la tendance au patinage par temps de pluie. Un second prototype, numéroté AP 2, est construit en fin d'année, il effectue ses premiers essais sur le CGM. Les AP 1 et 2 réalisent plusieurs voyages de démonstration, M. Laborie tentant de vendre son invention à d'autres réseaux, mais sans succès. Les deux autorails sont finalement mis en service régulier dès le 1er mars 1934 sur le réseau du Doubs. Sur rails secs, ces véhicules permettent d'appréciables gains de temps et l'AP 2 atteint même 100 km/h, record de vitesse sur voie métrique à l'époque. Une série de 5 autorails (AP 3-7) est finalement commandée par le Département du Doubs en 1934. Des problèmes surviennent sur les semi-pneus de ces véhicules et ils doivent être remplacés, ce qui améliore les performances des véhicules. Malgré cela, le Département résilie sa commande. M. Laborie est tout de même autorisé à poursuivre les essais sur le réseau et l'utilisation de roues avec interposition de semi-pneu entre le centre des roues et un bandage métallique donne de bons résultats en traction, mais le freinage ne répond plus aux normes. Un système de frein électromagnétique est testé mais il ne donne pas les résultats attendus et est abandonné. Les 5 autorails sont finalement tout de même mis en service sur le réseau en 1936, sur la base d'un contrat de location-vente (1 fr. par kilomètre, jusqu'à concurrence de 70'000 fr.). Les années suivantes, la fiabilité des autorails s'améliore et ils sont régulièrement utilisés. Avec le déclenchement de la seconde guerre mondiale et le regain de trafic, ces autorails de trop faible capacité sont garés. A la fin de la guerre, les CFD les louent au département du Jura qui les emploie dès 1945 sur la ligne Lons-le-Saunier - St-Claude des CFV en remplacement des autocars. Certains autorails reviennent dans le Doubs en 1946, mais ils sont peu utilisés, en raison de leur faible capacité, puis sont remplacés par de nouveaux autorails. Après la suppression du trafic voyageur en 1950, l'un est transformé en camionnette et les autres démolis. Le chemin de fer de Bretenoux-Biars à Saint-Céré / Elie Mandrillon in Chemins de fer régionaux et tramways, N°377 (septembre/octobre 2016)
Titre : Le chemin de fer de Bretenoux-Biars à Saint-Céré Type de document : texte imprimé Auteurs : Elie Mandrillon, Auteur Année de publication : 2016 Article en page(s) : P. 4-25 Langues : Français Catégories : [Mots-clefs] Autorail
[Mots-clefs] Caractéristique technique
[Mots-clefs] Chemin de fer privé
[Mots-clefs] Compagnie
[Mots-clefs] Construction
[Mots-clefs] Exploitation
[Mots-clefs] Finance
[Mots-clefs] France
[Mots-clefs] Histoire
[Mots-clefs] Locomotive à vapeur
[Mots-clefs] Locotracteur
[Mots-clefs] Lot (département)
[Mots-clefs] Parc de véhicules
[Mots-clefs] Projet
[Mots-clefs] Réseau
[Mots-clefs] Suppression
[Mots-clefs] Voiture
[Mots-clefs] Wagon
[Compagnie] BSC
[Ligne] Bretenoux-Biars
[Ligne] St-Céré
[Année] 1867-1936Index. décimale : 4390 Chemin de fer interurbain et vicinal - histoire - généralités Résumé : Démarrée en 1905, la construction de la ligne reliant Bretenoux-Biars à St-Céré, dans le département du Lot, connait de nombreux retards en raison du manque de finances de la compagnie. La ligne est mise en service en 1907, après un changement de compagnie. Dès le début de l'exploitation, la construction économique et le matériel de traction sous-dimensionné causent des problèmes, qui ne feront que s'accentuer au fil des ans suite au manque d'entretien. Ni la reprise de la ligne en régie par le département, ni la mise en service d'autorails ne parviennent à améliorer la situation et les trains sont remplacés par des bus dès 1933. La ligne est déclassée en août 1936, alors que la voie a déjà été déposée au printemps de la même année.
in Chemins de fer régionaux et tramways > N°377 (septembre/octobre 2016) . - P. 4-25[article] Le chemin de fer de Bretenoux-Biars à Saint-Céré [texte imprimé] / Elie Mandrillon, Auteur . - 2016 . - P. 4-25.
Langues : Français
in Chemins de fer régionaux et tramways > N°377 (septembre/octobre 2016) . - P. 4-25
Catégories : [Mots-clefs] Autorail
[Mots-clefs] Caractéristique technique
[Mots-clefs] Chemin de fer privé
[Mots-clefs] Compagnie
[Mots-clefs] Construction
[Mots-clefs] Exploitation
[Mots-clefs] Finance
[Mots-clefs] France
[Mots-clefs] Histoire
[Mots-clefs] Locomotive à vapeur
[Mots-clefs] Locotracteur
[Mots-clefs] Lot (département)
[Mots-clefs] Parc de véhicules
[Mots-clefs] Projet
[Mots-clefs] Réseau
[Mots-clefs] Suppression
[Mots-clefs] Voiture
[Mots-clefs] Wagon
[Compagnie] BSC
[Ligne] Bretenoux-Biars
[Ligne] St-Céré
[Année] 1867-1936Index. décimale : 4390 Chemin de fer interurbain et vicinal - histoire - généralités Résumé : Démarrée en 1905, la construction de la ligne reliant Bretenoux-Biars à St-Céré, dans le département du Lot, connait de nombreux retards en raison du manque de finances de la compagnie. La ligne est mise en service en 1907, après un changement de compagnie. Dès le début de l'exploitation, la construction économique et le matériel de traction sous-dimensionné causent des problèmes, qui ne feront que s'accentuer au fil des ans suite au manque d'entretien. Ni la reprise de la ligne en régie par le département, ni la mise en service d'autorails ne parviennent à améliorer la situation et les trains sont remplacés par des bus dès 1933. La ligne est déclassée en août 1936, alors que la voie a déjà été déposée au printemps de la même année. Les conseils généraux et leurs chemins de fer / Jacques Pèrenon in Transports et patrimoine ferroviaires, N° 419 (Septembre/Octobre 2023)
Titre : Les conseils généraux et leurs chemins de fer : morceaux choisis de politique ferroviaire locale : les chemins de fer départementaux de la Dordogne, l'improbable résurrection d'un réseau déclinant Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques Pèrenon, Auteur ; Elie Mandrillon, Collaborateur ; Gérard Perrot, Cartographe Année de publication : 2023 Article en page(s) : P. 15-25 Note générale : Suite du numéro 418. Langues : Français Catégories : [Mots-clefs] Chemin de fer
[Mots-clefs] Dordogne
[Mots-clefs] France
[Mots-clefs] Réseau
[Mots-clefs] Suppression
[Mots-clefs] Transport de marchandise
[Mots-clefs] Transport de voyageur
[Compagnie] CFD
[Ligne] Bergerac
[Ligne] Périgueux
[Ligne] St-Pardoux-la-Rivière
[Ligne] St-Yrieix
[Année] 1947-1949Index. décimale : 4314 Chemin de fer interurbain et vicinal - réseau - fermeture de ligne, ligne fermée Résumé : Alors que la modernisation des chemins de fer de la Dordogne, décidée à l'issue de la seconde guerre mondiale, est sur le point de s'achever, l'Assemblée départementale demande en 1947, à l'instigation des représentants de cantons non desservis par le chemin de fer, au service du Contrôle des Ponts et Chaussées de procéder à une étude de remplacement de la voie ferrée par des services routiers dans le but de réduire le déficit. Ce rapport est présenté à la fin de l'année. Il est très partial et conclut à la faisabilité du transfert sur route sans véritablement se pencher sur la situation du transport routier à l'époque, encore soumis à des restrictions, et des risques d'un nouveau conflit qui le remettrait à l'arrêt. La suppression du réseau est approuvée le 15 janvier 1948 par 20 voix pour, 13 contre et deux abstentions, à l'issue d'une séance aux débats passionnés. L'opposition des populations desservies et du personnel du réseau n'offrira que quelques mois de sursis au chemin de fer, dont la dernière ligne disparaitra le 1er juillet 1949.
in Transports et patrimoine ferroviaires > N° 419 (Septembre/Octobre 2023) . - P. 15-25[article] Les conseils généraux et leurs chemins de fer : morceaux choisis de politique ferroviaire locale : les chemins de fer départementaux de la Dordogne, l'improbable résurrection d'un réseau déclinant [texte imprimé] / Jacques Pèrenon, Auteur ; Elie Mandrillon, Collaborateur ; Gérard Perrot, Cartographe . - 2023 . - P. 15-25.
Suite du numéro 418.
Langues : Français
in Transports et patrimoine ferroviaires > N° 419 (Septembre/Octobre 2023) . - P. 15-25
Catégories : [Mots-clefs] Chemin de fer
[Mots-clefs] Dordogne
[Mots-clefs] France
[Mots-clefs] Réseau
[Mots-clefs] Suppression
[Mots-clefs] Transport de marchandise
[Mots-clefs] Transport de voyageur
[Compagnie] CFD
[Ligne] Bergerac
[Ligne] Périgueux
[Ligne] St-Pardoux-la-Rivière
[Ligne] St-Yrieix
[Année] 1947-1949Index. décimale : 4314 Chemin de fer interurbain et vicinal - réseau - fermeture de ligne, ligne fermée Résumé : Alors que la modernisation des chemins de fer de la Dordogne, décidée à l'issue de la seconde guerre mondiale, est sur le point de s'achever, l'Assemblée départementale demande en 1947, à l'instigation des représentants de cantons non desservis par le chemin de fer, au service du Contrôle des Ponts et Chaussées de procéder à une étude de remplacement de la voie ferrée par des services routiers dans le but de réduire le déficit. Ce rapport est présenté à la fin de l'année. Il est très partial et conclut à la faisabilité du transfert sur route sans véritablement se pencher sur la situation du transport routier à l'époque, encore soumis à des restrictions, et des risques d'un nouveau conflit qui le remettrait à l'arrêt. La suppression du réseau est approuvée le 15 janvier 1948 par 20 voix pour, 13 contre et deux abstentions, à l'issue d'une séance aux débats passionnés. L'opposition des populations desservies et du personnel du réseau n'offrira que quelques mois de sursis au chemin de fer, dont la dernière ligne disparaitra le 1er juillet 1949. Les conseils généraux et leurs chemins de fer / Jacques Pèrenon in Transports et patrimoine ferroviaires, N° 418 (Juillet/Août 2023)
Titre : Les conseils généraux et leurs chemins de fer : morceaux choisis de politique ferroviaire locale : les chemins de fer départementaux de la Dordogne, l'improbable résurrection d'un réseau déclinant : première partie Type de document : texte imprimé Auteurs : Jacques Pèrenon, Auteur ; Elie Mandrillon, Collaborateur ; Gérard Perrot, Cartographe Année de publication : 2023 Article en page(s) : P. 4-15 Note générale : Suite des numéros 408 et 409 Langues : Français Catégories : [Mots-clefs] Aménagement du territoire
[Mots-clefs] Autorail
[Mots-clefs] Bus
[Mots-clefs] Chemin de fer privé
[Mots-clefs] Dordogne
[Mots-clefs] Exploitation
[Mots-clefs] Faillite
[Mots-clefs] France
[Mots-clefs] Guerre 1914-18
[Mots-clefs] Guerre 1939-45
[Mots-clefs] Haute-Vienne
[Mots-clefs] Histoire
[Mots-clefs] Modernisation
[Mots-clefs] Remplacement
[Mots-clefs] Réseau
[Mots-clefs] Suppression
[Mots-clefs] Transport de marchandise
[Mots-clefs] Transport de voyageur
[Compagnie] CFD
[Compagnie] CFP
[Compagnie] TD (Dordogne)
[Ligne] Bergerac
[Ligne] Périgueux
[Ligne] Sarlat
[Ligne] St-Mathieu
[Ligne] St-Pardoux-la-Rivière
[Ligne] St-Yrieix
[Ligne] Thiviers
[Ligne] Vergt
[Ligne] Villefranche-du-Périgord
[Année] 1887-1947Index. décimale : 4390 Chemin de fer interurbain et vicinal - histoire - généralités Résumé : A la fin du 19e siècle, les Chemins de fer du Périgord (CFP) mettent en service un réseau de trois lignes centré sur Périgueux. Celui-ci est complété par les lignes des Tramways de la Dordogne, mises en service en 1912. Ce dernier réseau, constitué de quatre lignes isolées (dont trois prolongent les lignes des CFP) est mis sous séquestre du Département dès octobre 1914. Sa seule année complète d'exploitation avant la guerre, 1913, s'est déjà soldée par un déficit. Les CFP résistent à la guerre, mais pas à la concurrence routière qui la suit. Ils sont à leur tour mis sous séquestre en 1920. La régie départementale s'attelle à la réhabilitation et à la rationalisation des réseaux fusionnés. Elle acquiert également deux automotrices pétroléo-électriques. Une fois ces travaux menés, le Département recherche une entreprise spécialisée à qui affermer le réseau. Le choix se porte sur les CFD, qui reprennent l'exploitation le 1er janvier 1926. Avec la concurrence routière, les comptes se dégradent et les élus décident le remplacement des trains de voyageurs par des bus à compter du 1er mars 1933. L'année suivante, la quasi totalité de l'ancien réseau TD est supprimée. Retournement de situation en 1937: des considérations d'aménagement du territoire conduisent les élus à acquérir 12 autorails pour relancer les transports ferroviaires des voyageurs. Le nouveau service est un succès. Avec le déclenchement de la Seconde guerre mondiale, les autorails sont arrêtés et les trains à vapeur reprennent du service. Dès juin 1942, les autorails, munis de gazogène, reprennent du service. Après la guerre, de multiples travaux de remise en état du réseau sont menés et la construction locale de trois locotracteurs permet pratiquement de se passer de la traction vapeur.
in Transports et patrimoine ferroviaires > N° 418 (Juillet/Août 2023) . - P. 4-15[article] Les conseils généraux et leurs chemins de fer : morceaux choisis de politique ferroviaire locale : les chemins de fer départementaux de la Dordogne, l'improbable résurrection d'un réseau déclinant : première partie [texte imprimé] / Jacques Pèrenon, Auteur ; Elie Mandrillon, Collaborateur ; Gérard Perrot, Cartographe . - 2023 . - P. 4-15.
Suite des numéros 408 et 409
Langues : Français
in Transports et patrimoine ferroviaires > N° 418 (Juillet/Août 2023) . - P. 4-15
Catégories : [Mots-clefs] Aménagement du territoire
[Mots-clefs] Autorail
[Mots-clefs] Bus
[Mots-clefs] Chemin de fer privé
[Mots-clefs] Dordogne
[Mots-clefs] Exploitation
[Mots-clefs] Faillite
[Mots-clefs] France
[Mots-clefs] Guerre 1914-18
[Mots-clefs] Guerre 1939-45
[Mots-clefs] Haute-Vienne
[Mots-clefs] Histoire
[Mots-clefs] Modernisation
[Mots-clefs] Remplacement
[Mots-clefs] Réseau
[Mots-clefs] Suppression
[Mots-clefs] Transport de marchandise
[Mots-clefs] Transport de voyageur
[Compagnie] CFD
[Compagnie] CFP
[Compagnie] TD (Dordogne)
[Ligne] Bergerac
[Ligne] Périgueux
[Ligne] Sarlat
[Ligne] St-Mathieu
[Ligne] St-Pardoux-la-Rivière
[Ligne] St-Yrieix
[Ligne] Thiviers
[Ligne] Vergt
[Ligne] Villefranche-du-Périgord
[Année] 1887-1947Index. décimale : 4390 Chemin de fer interurbain et vicinal - histoire - généralités Résumé : A la fin du 19e siècle, les Chemins de fer du Périgord (CFP) mettent en service un réseau de trois lignes centré sur Périgueux. Celui-ci est complété par les lignes des Tramways de la Dordogne, mises en service en 1912. Ce dernier réseau, constitué de quatre lignes isolées (dont trois prolongent les lignes des CFP) est mis sous séquestre du Département dès octobre 1914. Sa seule année complète d'exploitation avant la guerre, 1913, s'est déjà soldée par un déficit. Les CFP résistent à la guerre, mais pas à la concurrence routière qui la suit. Ils sont à leur tour mis sous séquestre en 1920. La régie départementale s'attelle à la réhabilitation et à la rationalisation des réseaux fusionnés. Elle acquiert également deux automotrices pétroléo-électriques. Une fois ces travaux menés, le Département recherche une entreprise spécialisée à qui affermer le réseau. Le choix se porte sur les CFD, qui reprennent l'exploitation le 1er janvier 1926. Avec la concurrence routière, les comptes se dégradent et les élus décident le remplacement des trains de voyageurs par des bus à compter du 1er mars 1933. L'année suivante, la quasi totalité de l'ancien réseau TD est supprimée. Retournement de situation en 1937: des considérations d'aménagement du territoire conduisent les élus à acquérir 12 autorails pour relancer les transports ferroviaires des voyageurs. Le nouveau service est un succès. Avec le déclenchement de la Seconde guerre mondiale, les autorails sont arrêtés et les trains à vapeur reprennent du service. Dès juin 1942, les autorails, munis de gazogène, reprennent du service. Après la guerre, de multiples travaux de remise en état du réseau sont menés et la construction locale de trois locotracteurs permet pratiquement de se passer de la traction vapeur. Les conseils généraux et leurs chemins de fer / Jacques Pèrenon in Transports et patrimoine ferroviaires, N° 421 (Janvier/Février 2024)
PermalinkLa France des trains de campagne / François Fontaine
PermalinkN° 383 - septembre/octobre 2017 - Un chemin de fer en Chartreuse (Bulletin de Chemins de fer régionaux et tramways) / Dominique Boblet
PermalinkN° 396 - novembre/décembre 2019 - Les tramways de l'Ardèche (Bulletin de Chemins de fer régionaux et tramways) / Elie Mandrillon
PermalinkLes tramways électriques dans le Loir-et-Cher / Elie Mandrillon in Chemins de fer régionaux et tramways, N° 401 (septembre/octobre 2020)
PermalinkLes tramways d'hier en France / Elie Mandrillon
Permalink